Le quartier français de Hanoi : Un voyage dans l'histoire coloniale
Le quartier français
Hier comme aujourd’hui, ce quartier francais de Hanoi contraste fortement avec le reste de la cité. Construit fin du 19ème, c’est aujourd’hui un des sites emblématiques de la Capitale vietnamienne, s’étirant au sud du lac Hoan Kiem et le contournant vers l’ouest.

Court rappel historique
1802 : Hue devient la capitale impériale du Vietnam, Hanoi n’est plus le centre politique du pays. Le quartier qui entoure la citadelle se dégrade rapidement, les hauts dignitaires quittent l’ancienne capitale, tandis que le vieux quartier et ses corporations continue de se développer et le commerce avec lui.
1873 : les colons français arrivent à Hanoi. Ils imprimeront de façon presque indélébile le paysage urbain au sud et à l’ouest de Ho Guom : ce ne sera que vastes et belles villas, grandes avenues ombragées, cinémas, cafés, restaurants, boutiques et hôtels de luxe. Comme le souligne Paul Doumer, Gouverneur General de l’Indochine Française : «Tout était permis, pourvu qu’on inscrivît la puissance coloniale dans la pierre». Du vieil Hanoi, les Français veulent faire table rase et rebâtir une cite plus dense, plus moderne. Ils assèchent lacs et rivières, remblayent, démolissent, reconstruisent par-dessus, percent de nouvelles rue et avenues, en élargissent d’autres, font sauter les portes qui ouvraient sur les différents quartiers et ce faisant, détruisent ce qui faisait une grande partie du charme de Hanoi : sa structure de village urbain. Le paysage architectural se modifie en profondeur, les auvents des maisons traditionnelles vietnamiennes qui faisaient office de commerce sont détruites. En 1887, l’ancienne Thang Long est au cœur de modifications urbaines qui bouleverseront la ville à tout jamais, alors que les actuels Vietnam et Cambodge forment la fédération d’Indochine dont Hanoi sera bientôt la capitale. Rues, tramways, canalisations, drainages, démolitions et nouvelles constructions transforment la ville, une architecture européenne apparaît avec l’émergence du béton et de la brique, des trottoirs et… des rats.

Le massacre des rats à Hanoi
En 1902, Hanoi devient la capitale de l’Indochine Française (elle le restera jusqu’en 1954). A cette époque (nous parlons de l’année 1897), Paul Doumer en est le Gouverneur Général. Dès son arrivée, il n’aura de cesse de lancer des travaux colossaux, d’immenses projets d’infrastructures, pour faire de la cité entre les fleuves une vitrine éclatante de la mission civilisatrice de la France en Indochine. D’autant plus éclatante qu’il dotera la ville du tout premier réseau électrique d’Asie. C’est également sous son impulsion que les toilettes – symbole ultime d’une civilisation éclairée et sage – feront partie de toute maison coloniale. C’est d’ailleurs pour cette raison que le quartier français se dote d’un réseau d’égouts. La « ville indigène » - comprenez le vieux quartier des 36 rues – n’avait droit tout au plus qu’un a modeste « système de drainage ». Ce que le génie flamboyant de la civilisation occidentale n’avait pas anticipé, c’est que ce réseau d’évacuation des eaux usées allait devenir le refuge de prédilection des rats. Ce qui a rapidement posé des problèmes d’hygiène, on s’en doute bien, mais également un sentiment de peur panique. La redoutable Yersinia pestis, cette peste bubonique découverte par le devenu célèbre Alexandre Yersin en 1894 – autant dire hier – étant toujours profondement ancrée dans les esprits. Que fit l’administration coloniale pour éradiquer le fléau ? Elle mit sur pied une armée de « chasseur de rats ». La légende rapporte que ces valeureux travailleurs vietnamiens auraient ramené jusqu’à 20 000 rats par jour. Ce qui de toute façon n’était pas suffisant pour endiguer leur prolifération. On change donc de politique en agrémentant la chasse d’une prime par bestiole tuée, par chasseur, par jour. Pour s’éviter la corvée d’avoir à se débarrasser du cadavre des rongeurs, il était demandé aux chasseurs de ne revenir qu’avec la queue de la bête en question. Erreur ! Grosse erreur ! Il était nettement plus profitable, pécuniairement parlant, pour le chasseur de couper la queue et de relâcher le rat, ce dernier – au vu de son ardeur à se reproduire – étant certain d’assurer de prochaines primes. Certains se sont même mis à l’élevage, jurant qu’ils étaient d’égouts et non des champs…
L’administration coloniale – au bout d’un certain temps, tout de même – s’est aperçue du stratagème et a mis fin au programme « chasseurs de rats ». Malheureusement, le destin voulut qu’en 1906, la si redoutée peste bubonique fit 263 morts parmi les Vietnamiens de Hanoi.

Les sites majeurs du quartier français
La Cathédrale Saint-Joseph
Flash back
Second Empire, Napoléon III choisit Hanoi comme capitale de l’Indochine française. L’impératrice Eugenie, connue pour être plus catholique que la très catholique Isabelle d’Espagne, pousse l’empereur à défendre les intérêts de cette religion de paix et d’amour dans les contrées lointaines du monde et donc au Vietnam. Pour que rayonne le catholicisme, de nombreux temples et pagodes sont détruits, des lieux de cultes saccagés. Hanoi pleure de très nombreuses pertes, la cité millénaire regorgeant de sites sacrés. L’exemple peut-être le plus brutal de cette destruction massive fut l’anéantissement d’un vénérable et très beau monastère du 11ème siècle dont on disait que le stupa était l’une des 4 merveilles du Pays du Dragon. A la place de ce plus grand monastère impérial des Ly (Bao Thien) bâti en 1056-1057, on construisit la Cathédrale Saint-Joseph que l'écrivain Albert de Pouvourville décrivait à l’époque comme un "Chef d'œuvre de grandeur et de laideur". A peu près en même temps que le monastère impérial Bao Thien, c’est la pagode Bao An qui est rasée (ne reste que la tour Hoa Phong, sur la rive du lac Hoan Kiem). On confond souvent ces deux sites, Bao Thien et Bao An, peut-être à la fois pour leur proximité géographique et leur période de destruction, mais aussi pour leur similitude de sens : Bao Thien signifiant « Monastère de la Gratitude envers le Ciel » et Bao An, « Pagode de la Gratitude » (et non des Supplices comme l’ont affublé les Français).
Edifiée entre 1886 et 1887, Nha Tho Lon Ha Noi est aujourd’hui une des 7 plus grandes églises de la Capitale du Vietnam, c’est également la plus ancienne. De style néo-gothique, sa ressemblance avec Notre-Dame de Paris n’est pas fortuite. Pour autant, sa première version était tout en bois. En 1884, elle sera agrandie en briques et en granit selon les plans de Mgr Puginier, alors vicaire du Tonkin occidental. Elle sera inaugurée Noel 1887. Située rue Nha Chung (Rue de l’église), à l’ouest de Hoan Kiem, elle a le patronyme du saint patron du Vietnam et de l'Indochine (c’est le pape Innocentinus XI qui en avait décidé ainsi) : Joseph. Elle constitue le siège de l'archidiocèse catholique romain de Hanoi.

Architecture de la Cathédrale Saint-Joseph de Hanoi
Financée grâce à un système de loterie, la construction débute en 1882, pour être agrandie en 1884 et terminée pour la célébration de la messe de Noel 1887. Elle est très fortement inspirée de l’architecture gothique médiévale (un courant architectural qui prévaudra du 12ème siècle jusqu’à la Renaissance en France), reconnaissable à ses grandes arches s’élevant vers le ciel. Le bâtiment mesure 64,5 mètres de long sur 20,5 m de large et ses deux clochers culminent à 31,5 m de hauteur. Une croix de pierre vient coiffer la toiture. Faite de brique et de chaux, la façade a subit les outrages du temps et de la pollution. Mais en pénétrant dans l’église, le temps semble figé dans une architecture intacte. L’influence orientale se voit dans la décoration aux motifs populaires traditionnels, rehaussés par la douce lumière des vitraux importés de France. L’intérieur préserve un Saint-Joseph en terre cuite de plus de 2 m.
L’église possède également un ensemble de 4 petites cloches plus une grande. Située dans un quartier bordé de maisons coloniale, Saint-Joseph est une destination incontournable pour les amoureux des vieilles pierres à l’ambiance un peu nostalgique de thé au citron accompagné de graines de tournesol et les inévitables fans de selfies.
En pratique
Heures d’ouverture (heure des offices) :
En semaine : 5h30 et 18h15 – Les samedis : 18 h et les dimanches : 5h00, 7h00, 9h00, 11h00, 16h00, 18h00 et 20h00
Adresse : 40 rue Nhà Chung, à l’angle des Nha Chung et Nha Tho

La prison Hoa Lo
1886 est également l’année de la construction de la prison Hoa Lo. Avec Con Dao, elle obtiendra au fil du temps la sinistre réputation d’être une des prisons les plus inhumaines du Vietnam.
Située rue Hoa Lo, le centre pénitencier a été construit sur l’emplacement d’un ancien village de potiers du nom de Phu Khanh, connu en particulier pour ses articles de cuisson : marmites, casseroles, poêles… D’où le nom de Hoa Lo, qui signifie « poêle en terre cuite ». Les Français ont déplacé les villageois et détruit les pagodes Luu Ly, Bich Thu et Bich Hoai pour construire en lieu et place la Prison Centrale de Hoa Lo, avec un tribunal et des bâtiments administratifs. Assez rapidement, les colons ont dû faire face à des mouvements anti-français et ont donc été amenés à construire un nombre assez conséquent de prisons dans tout le Pays pour y enfermer les contestataires politiques et autres révolutionnaires pro-indépendance. D’ailleurs, les travaux n’étaient pas encore terminés, qu’en 1899, Hoa Lo accueillait ses premiers pensionnaires qui seront – comme tous ceux à venir - torturés puis exécutes.
Occupant les 12 908 mètres carrés de l’ancien village, la prison faisait face au Palais de Justice à l’Est et était délimitée au sud-ouest par la rue Tho Nhuom, par la rue Richaud (aujourd'hui rue Quan Su) à l’Ouest et au Nord par l’ancienne rue Rollandes, aujourd'hui rue Hai Ba Trung. Le complexe, étudié pour réprimer sévèrement tout opposant au régime, comprenait également une infirmerie, un petit hôpital, des ateliers ainsi que le quartier des condamnés à morts, repérable à sa guillotine. Le tout étant gardé par un mur d’enceinte de 4 m de haut, flanqué à ses angles de 4 miradors. La construction en elle-même a suivi un cahier des charges particulièrement drastique et méticuleux, comme en témoigne son article 17 : «Tout métal utilisé doit être importé de France et de qualité supérieure. Les serrures à charnière, les châssis, les goujons à crochets et les coins de porte sont de qualité supérieure et acceptés par l'architecte. Toutes les serrures et fixations métalliques doivent être soigneusement placées et installées dans les fentes et rainures disponibles ». L’article 19 stipulera quant à lui que le verre également devra provenir de France.
La Prison Centrale sera constamment agrandie, rénovée, réparée. En 1912, elle inaugure un quartier pour les enfants (!) - alors que les sanitaires ne seront mis en place qu’en 1917 - et en 1913, elle voit sa capacite passer de 450 à 600 prisonniers. Mais en 1916, la prison comptait déjà plus de 730 prisonniers, plus de 890 en 1926 pour arriver à 1430 en 1933. Les années 1950 verront les cellules dépasser les 2 000 internés.
Si Hoa Lo accueillait essentiellement des prisonniers politiques, elle pouvait également recevoir des prisonniers de droit commun. La gestion de l’époque était de garder à la Prison Centrale les prisonniers condamnés à 5 ans ou à mort et de transférer les autres sur Son La ou Con Dao.
La répression a été brutale et beaucoup de Vietnamiens sont morts ici dans d’atroces souffrances. D’autres auront eu le temps de propager la doctrine révolutionnaire derriere les barreaux, minant de l’intérieur les efforts de l’administration coloniale… Il n’est pas exagéré de dire qu’une partie de la guerre pour l’indépendance s’est jouée ici, dans les cachots de Hoa Lo.
Apres la chute de Dien Bien Phu en 1954 et donc la fin de l’Indochine française, Hoa Lo prend le nom de "Centre de détention des prisonniers de Hanoi". Pendant la guerre contre les Américains, elle « hébergera » de 1964 à 1973 les pilotes capturés, ces derniers la surnommeront « Hilton Hanoi ».
Aujourd’hui devenue musée et lieu de mémoire, Hoa Lo offre au visiteur une visite en forme de réflexion, passées les émotions devant le spectacle macabre des geôles, des conditions de vie des prisonnières avec leurs enfants et autres évocations terribles, mais mis en scène avec intelligence (même si dans la partie réservée aux prisonniers vietnamiens, le discours est fortement marqué par un patriotisme exacerbé…).

En pratique :
Heures d’ouverture : tlj de 8h à17 h
Adresse : No.1 Hoa Lo, Tran Hung Dao, district de Hoan Kiem
L’Opéra de Hanoi et la rue Trang Tien, anciennement rue Paul Bert
L'Atlas Colonial Illustré décrit Hanoi (vers 1925) comme : " la capitale et la ville la plus peuplée du Tonkin, au centre d'un réseau de navigation, sur le song-Koi ou fleuve rouge et à 150 km de la mer. Sa population est de 105 000 habitants : 3 000 européens, 100 000 annamites et 2 000 chinois. Entourée de levée de défense et de belles promenades, elle englobe une centaine de villages et se divise en 7 quartiers, plus un extérieur. C'est une ville importante et coquette ; on y trouve un quartier européen et une ville indigène. Une partie de la population est flottante ; elle vit sur les jonques et les bateaux. Les rues de la ville européenne sont dallées de marbre. Un petit lac intérieur lui donne un aspect pittoresque et charmant. Elle est appelée à devenir le siège du gouvernement de l'Indochine."

L’Opéra de Hanoi
Apres 9 ans de travaux (1901-1910, inauguration en 1911), l’Opera de Hanoi symbolise cet art de vivre à la française dans l’Indochine coloniale. Son architecture néoclassique s’inspire de l’Opéra Garnier de Paris, avec des thèmes gothiques sur ses portes et ses dômes, multipliant les piliers, les fenêtres et les balcons. Né dans l’esprit fécond des architectes Harlay et Broyer, c’est également le plus vaste théâtre du Vietnam. Difficile d’imaginer que le site était auparavant un vaste marécage hébergeant les deux hameaux de Thach Tan et Tay Luong ! En 1899, est lancé le projet de construire un opéra sur ce lieu. Les travaux débuteront le 7 juin 1901, sous la direction de l’architecte Harlay en personne. Le nivellement est difficile, la nature du terrain impose de planter 35 000 poteaux en bambou et de placer des blocs de béton pour stabiliser le sol. Chaque jour 300 ouvriers sont à la tâche. Les chiffres font tourner la tête : la construction aura nécessité plus de 12 000 m3 de matériaux et près de 600 tonnes de fer et d'acier pour un ouvrage repressentant une superficie de 2 600m2, avec une longueur de 87 m sur une largeur de 30 m. Le point le plus haut de l'ouvrage par rapport à la surface de la route est de 34 m. La construction a couté 2 000 000 de francs de l’époque… Une impressionnante volée de marches part de la Place de la Révolution d'Août pour pénétrer dans un intérieur spectaculaire d’environ 900 places. On y jouait des pièces classiques 4 fois par semaine : les mardis, jeudis, samedis et dimanches.
De par son rayonnement et son importance, l’Opéra de Hanoi a été le théâtre de nombreux évènements historiques, notamment pendant la révolution d’aout et les tout débuts de la jeune République démocratique du Vietnam. L’histoire retiendra en particulier le 17 août 1945, date d’un meeting sur la place de l'opéra, qui donnera naissance au Viet Minh. La population de Hanoi découvrira alors le drapeau rouge à étoile d’or au balcon du deuxième étage de l’opéra. Le 29 août 1945, l'armée de libération du Viet Bac entre dans Hanoi et converge vers la place de l'Opéra. Le 2 mars de l’année suivante, ce sera la première session de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Vietnam au sein de l'Opéra, suivie – le 2 septembre de la même année 1946 – de la cérémonie de célébration d'une année de gouvernement de la République démocratique du Vietnam, en présence de Oncle Ho. Nha Hat Lon Ha Noi a même été cinéma des armées au début des années 1950.
Des travaux de restauration et de mises aux normes débuteront en 1994 pour se terminer en 1997, à l’occasion du sommet de la Francophonie.
Œuvre unique dans sa dimension culturelle et historique, l’Opera de Hanoi participe au rayonnement de la Capitale vietnamienne. Renseignez-vous sur la programmation en cours auprès d’une agence de voyage basée sur Hanoi, si vous souhaitez assister à une des nombreuses manifestations culturelles de l’opéra de Hanoi.

En pratique :
Adresse : No.01 Trang Tien - Hoan Kiem District - Hanoi - Vietnam
Site Web: www.hanoioperahouse.org.vn
La rue Trang Tien
La rue Paul Bert, actuellement rue Trang Tien, est la voie commerçante du quartier français. Elle part de l’opéra de Hanoi pour rejoindre le lac Hoan Kiem. Autrefois appelée également rue de France, elle tire son nom d’un physiologiste et homme politique français né un 19 octobre 1833 à Auxerre : Paul Bert. Celui-ci sera nommé Président Général du protectorat de l'Annam-Tonkin en 1886, année de son arrivée à Hanoi. Il y meurt 7 mois plus tard du choléra. Cette rue a toujours été le siège de nombreux et prestigieux commerces, dont les célèbres magasins "Magasin Chaffanjon" (Lacombe, Bousquet & Bidault) sis au 34, rue de France. Ceux-ci font face au siège de la Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l'Industrie, au numéro 25. En 1902, Hanoi se veut être le modèle de l’élégance et de l’art de vivre à la française : c’est de cette époque que datent les avenues de style haussmannien et ses bâtiments très Second Empire dont l’Opéra en haut de la rue, en est le parfait exemple. Les villas entourées de leurs petits jardins donneront cette touche provinciale émouvante au petit Paris du Tonkin. La rue Paul Bert verra aussi une Agence Peugeot, le plus ancien garage du Nord-Vietnam, au numéro 1. Le cinéma Eden trônait au 48 alors que l’Imprimerie d’Extrême-Orient - société au capital de 7 800 000 piastres (!) – était sise aux 24 - 28, rue de France (Aujourd’hui y réside l’Institut Français de Hanoi – l’Espace). Sans oublier les Grands Magasins Réunis, où la bourgeoisie française mais également vietnamienne aimait à venir y faire quelques emplettes. Aujourd’hui encore la rue Trang Tien est un petit champ Elysée où les boutiques rivalisent d’élégance et de charme.

L’hôtel Métropole
Situé autrefois boulevard Henri Rivière, aujourd’hui rue Ngo Quyen, l’hôtel Métropole est le premier établissement à avoir reçu 5 Etoiles à Hanoi. Il date de 1901, créé par l’architecte Gustave-Émile Dumoutier. En 1916, il a été le premier établissement d’Indochine à proposer des projections de cinéma. Son histoire commence en 1899 : un certain Gustave-Émile Dumoutier dépose une demande de conversion des immeubles de son terrain au coin du boulevard Henri Rivière en hôtel. 500 000 francs de l’époque sont mis sur la table par l'homme d'affaires André Ducamp, les travaux peuvent commencer. L’etablissement ouvrira en 1901 sous la direction conjointe de Ducamp et de Dumoutier.
De très nombreuses célébrités y ont séjourné, il a également été – et est toujours - le lieu de nombreuses et importantes conférences. Une architecture intemporelle, des lignes modernes et une atmosphère comme nulle part ailleurs ont séduit des personnalités comme Charlie Chaplin et sa jeune épouse Paulette Goddard, qui y passeront leur lune de miel, Jane Fonda et Joan Baez ont profité du bunker de l’hôtel pendant la guerre du Vietnam, Somerset Maugham y écrira « The Gentleman in the Parlour” tandis que Graham Green y faisait halte alors qu’il rédigeait “The quiet American”. Pour anecdote, le bunker a été fermé une fois la guerre terminée. Il ne sera redécouvert que par hasard, lors des travaux de restauration du Bamboo Bar en 2011. La direction a fait le choix de le garder et d’en faire un lieu de mémoire qui se visite sur le thème « Chemins de l’Histoire© ».
L’hôtel compte 364 chambres et se divise en 2 parties : le vieux Métropole et le Nouvel Opéra. Le premier espace est chargé d’histoire et présente une déco mettant en valeur des objets anciens combinant Occident et Orient, l’autre partie est résolument plus moderne avec un design contemporain au luxe discret.
Boire un verre au bar du Métropole fait partie de ces expériences indicibles d’une excursion à Hanoi.

En pratique :
Adresse : n ° 15, Ngo Quyen, quartier de Trang Tien, district de Hoan Kiem
Site Web: www.sofitel-legend-metropole-hanoi.com/en/
Envoyez-nous vos commentaires sur : Le quartier français de Hanoi : Un voyage dans l'histoire coloniale
Champs obligatoires *
Vous pourriez aussi être intéressé
Idées de voyage
Besoin d'inspiration ? Découvrez quelques-uns des meilleurs circuits au Vietnam, très appréciés par nos clients. Un excellent point de départ pour vous aider à choisir le voyage au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Birmanie ou en Thaïlande qui vous convient le mieux, que vous partiez seul, en couple, en famille ou entre amis.
Et parce que ce voyage est le vôtre, personnalisez-le comme bon vous semble !
Circuit Vietnam Cambodge 15 jours
Circuit Vietnam Cambodge 15 jours: temples d’Angkor, Phnom Penh et Mékong vers le Delta, Saigon et Cu Chi, puis Hoi An, Hué, Hanoi, Ninh Binh et croisière dans la baie d’Halong. Deux pays reliés par le fleuve mythique.
Circuit panorama du Vietnam 15 jours
Circuit panorama du Vietnam 15 jours : un voyage du nord au sud mêlant Hanoi historique, vallées de Mai Chau, baie d’Halong magique, Hue, Hoi An et delta du Mékong enchanteur.
Circuit Vietnam 15 jours
Ce Circuit Vietnam 15 jours vous entraîne du charme intemporel de Hanoi aux rizières de Mai Chau et Pu Luong, de la baie secrète de Bai Tu Long aux trésors de Hue et Hoi An, avant de vibrer au rythme du delta du Mékong et de Saigon.
Circuit Nord Vietnam 10 jours
Circuit Nord Vietnam 10 jours vous guide hors des sentiers battus, entre rizières en terrasse, vallées brumeuses, lacs paisibles et cascades grandioses, pour une immersion culturelle et humaine inoubliable
Croisière Mekong du Vietnam au Cambodge 12 jours
Croisière Mekong du Vietnam au Cambodge 12 jours est une odyssée fluviale inoubliable entre villages authentiques, paysages enchanteurs et découvertes culturelles uniques.
Circuit route des photographes 15 jours
Circuit Route des photographes Vietnam 15 jours vous permet de découvrir les belles rizières en terrasse, les marchés locaux et les ethnies colorées du Vietnam.
Ce circuit vous intéresse-t-il?
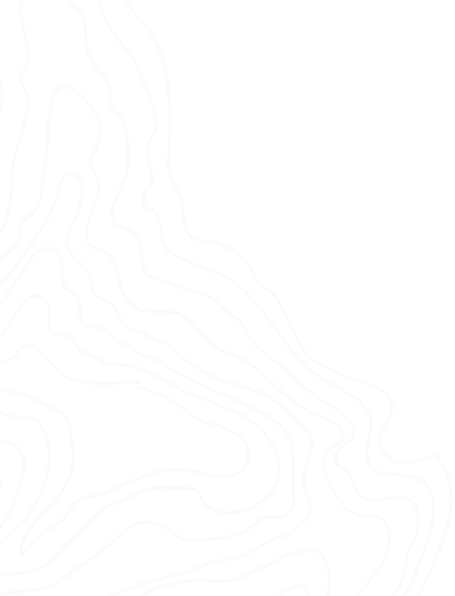












.jpg)



























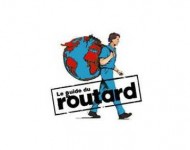



Commentaire