Héritage architectural de la période coloniale française à Hanoi
Cité millénaire, l’histoire de Hanoi peut se simplifier en 4 époques : les siècles de domination chinoise, la période de colonialisme français, la guerre contre les Américains dite guerre du Vietnam et Hanoi, la ville moderne. Quelle meilleure façon de comprendre l'histoire d'une ville autre qu'en visitant ses vestiges et notamment architecturaux ?

Il y a fort longtemps…
Environ 3 000 ans avec J.-C., il y avait des hommes, ici, sur cette terre qui allait héberger la ville entre les fleuves. Plus tard, vers 257 avec l’ère commune, une première colonie est créée, la citadelle de Co Loa est érigée (Les quelques ruines qui témoignent de l’ancienne capitale de l'État d'Au Lac sont situées près de Phong Khe, à environ 20 km au nord de Hanoi). Commandée par le roi An Duong Vuong, célèbre pour une arbalète magique et tristement célèbre pour avoir décapité sa fille, il ne reste de Co Loa que deux murs extérieurs et le bâtiment de la citadelle intérieure.
Entre le 2ème et le 8ème siècle de l’ère commune, Hanoi est intégrée à l'empire chinois sous le nom de « gouvernement du Jiaozhi ». Hanoi ou plutôt "Dai La" « la grande enceinte extérieure » restera sous tutelle chinoise jusqu'en 939.
C’est la date de 1010 de notre ère qui fait référence comme étant la date officielle de la fondation de Hanoi. D’un conglomérat de villages artisanaux, le roi Ly Thai Tho (Ly Cong Uan de son nom de naissance) a construit une ville capitale qu’il rebaptisera "Thang Long" « la cité du dragon qui s'élève ». C’est d’ailleurs sous son règne qu’a été érigé le Temple de la Littérature, en 1070 ; temple qui, 6 ans plus tard – en 1076 - allait devenir la première université du Vietnam, créée pour éduquer l'élite vietnamienne, autrement dit essentiellement les bureaucrates et la noblesse. Il existait un bourg, au Sud du Fleuve Rouge, qui s’appelait « Long Do » - le Nombril du Dragon. C’est sur cette butte qu’au 7ème siècle une citadelle chinoise avait été édifiée. Les souverains construiront sur ses vestiges un palais impérial qui défiera le temps pendant près de 8 siècles. La colline Nung, considérée comme étant le centre du Hanoi primitif et conservant l'esprit du Nombril du Dragon était particulièrement vénéré. Ce culte, avec celui rendu à la rivière To Lịich, transformée en divinité, est encore pratiqué aujourd'hui au temple Bach Ma à Dong Xuan, dans le quartier des 36 rues.
Les 800 années qui ont suivi ont été marquées par les invasions chinoises, périodiques et de plus ou moins longues durées. Ce qui a fini par affaiblir la ville. En 1802, la dynastie des Nguyen déplace la capitale impériale à Hue, faisant ainsi de Hanoi une proie facile, affaiblie et sur le déclin, pour les colons français fraichement débarqués. En 1887, quatre ans seulement après l'occupation française, Hanoi devient la capitale de l'Indochine française.

Héritage architectural français
Pendant la colonisation française au Vietnam, trois architectures coexistent : vietnamienne, française et coloniale. Avant la colonisation, le pays aux deux deltas était un lieu d’échange des styles architecturaux avec différents pays : l’architecture chinoise, l’architecture cham, et même l’architecture japonaise. Toutefois, l’architecture traditionnelle du Vietnam garde sa spécificité en accord avec le mode de vie, l’art et la culture des Vietnamiens.
A l’arrivée des Français dans Hanoi, la ville ne comptait que son ensemble de 36 rues, dont la plupart font maintenant partie du vieux quartier de Hanoi. Tout au long des années précédant l'occupation française, cette « zone commerciale » avait acquis une réputation de plaque tournante des affaires et du commerce dans le delta du fleuve Rouge. L’emblématique pagode au pilier unique et Bach Ma, l'un des plus anciens temples de Hanoi, se trouvent également dans le vieux quartier.
Il est coutume de dire que la présence française (1875-1945) a laissé des traces indélébiles dans l’architecture et l’urbanisme de Hanoi (on recense plus de 2 000 édifices coloniaux dans la Capitale). Si l'article sur le quartier francais à Hanoi se bornait à lister les sites majeurs du quartier dit français, intéressons-nous ici à l’architecture coloniale, son adaptation au climat et aux traditions du Vietnam. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il serait juste de préciser que l’influence française dans l’architecture s’est faite ressentir dès 1803, quand Gia Long, roi de la dynastie Nguyen, ordonne de reconstruire la ville en calquant sur le style Vauban.

L’architecture française à Hanoi, la période précoloniale
L’année 1873 est marquée par la conquête de Hanoi par les Français. Le colonialisme français de cette époque empruntait l’architecture indigène, soit en utilisant directement des logements existants, soit en construisant de nouveaux bâtiments selon la technologie locale. En d’autres termes, le gouvernement colonial a plutôt adopté le milieu de vie indigène pour en tirer profit en s’y adaptant et l’occupant temporairement. Mais l’introduction de nouveaux matériaux comme le ciment ou le béton armé changera le paysage architectural. Un paysage qu’on retrouvera plutôt dans les logements qu’occupaient les officiers français ainsi que les soldats dans les anciennes zones de concessions ; l’accent était mis sur un aspect plus pratique qu’esthétique. Le but était avant tout de se protéger des chaleurs qui peuvent être étouffantes en été.

L’architecture française à Hanoi, 1900 – 1920
L’implantation de l’architecture française à Hanoi s’est déroulée en deux étapes, dont la première – entre 1900 et 1920 – est caractérisée par une « imposition stricte de l’architecture française», donnant des bâtiments très… français, dans leur style et conception. L’allure est monumentale, avec des façades imposantes, manifestation de cette volonté d’afficher la stabilité du Protectorat et ses ambitions. Leur esthétique relevait plus de la démonstration de force que de l’adaptation au climat local. Les architectes français renommés de l’époque ont pour nom Henri Auguste Vildieu, André Bussy, Broger, Harioy… On citera comme exemples de cette architecture l’Opéra de Hanoi, l’Hôtel Métropole, la cathédrale Saint Joseph ou encore la Banque de l’Indochine et la gare de Hanoi. Parallèlement, des intellectuels coloniaux s’élèvent contre cette imposition d’une architecture coloniale et tentent de d’inventer un nouveau style pour remplacer le style classique importé tel quel de leur pays, tout en mettant en valeur les vestiges des architectures asiatiques. C’est ainsi qu’est apparu le style asiatique-européen, avec de premiers projets de bâtiment-modèle présentés aux expositions coloniales à Hanoi. Ceux-ci, plus spontanés que réfléchis, aux multiples références chinoises, exprimaient de façon très discutable les gouts personnels de leurs concepteurs. Il faut attendre la politique de cohérence d’Albert Sarraut, Gouverneur Général pendant deux mandats (1911-1914 et 1916-1919), pour qu’une réflexion soit engagée sur architecture, urbanisme et contraintes du pays. Ses idées directrices étaient : reniement d’une architecture “éclectique”, harmonisation des constructions avec les constructions anciennes, nécessité d’une direction de l’architecture centralisée. Et enfin, en raison des budgets, les constructions devaient être standardisées et conçues en fonction des priorités.

L’architecture française à Hanoi, 1921-1954
L’arrivée en 1923 de l’architecte en chef des bâtiments civils de l’Indochine – Ernest Hébrard – va complètement bouleverser la vision néo-classique des années précédentes. Précurseur et visionnaire, il créera le style indochinois : une architecture mixte, mariage de l’architecture traditionnelle locale avec le style occidental. De 1921 à 1954, l’architecture française au Vietnam s’est ainsi modifiée pour s’harmoniser avec l’environnement climatique et le mode de vie local.
Si le travail de Hébrard est manifeste et incontournable dans Hanoi, il a également laissé sa marque à Saigon, Dalat mais aussi à Phnom Penh. Les quelques années qu’il a passé en Indochine ont été incroyablement productives et influentes - nulle part plus qu’à Hanoi, créant certains des bâtiments coloniaux les plus importants qui aient survécu jusqu’à nos jours (malgré un 20ème siècle pour le moins bousculé…). Auparavant, l’architecte s’était taillé une très belle réputation… en Grèce, où il était responsable du réaménagement de Thessalonique, après le grand incendie de 1917, avant de devenir l’homme qui a créé le style architectural indochinois.
Les édifices les plus typiques de cette inspiration sont l’Université de l’Indochine (devenue Université nationale), la Recette générale des finances (devenue Ministère des Affaires Etrangères) et le musée Louis Finot de l’Ecole française d’Extrême-Orient (devenu le Musée national d’histoire vietnamienne).
Entre-temps, le style art-déco aura eu également ses heures de gloire. A la suite de la première guerre mondiale, les architectes occidentaux ont essayé de s’adapter au paysage vietnamien ainsi qu’à la culture. L’essor économique grandissant du pays a attiré une masse d’investisseur français, quelques chinois … Un grand nombre de bureaux de banques ou des entreprises ont adopté ce style, notamment la banque nationale, le centre culturel français à Hanoï, et bien entendu, les villas de l’arrondissement de la rue de Ba Dinh …

Témoignages de l’architecture coloniale à Hanoi
L’ancien hôtel "l'Avenir du Tonkin" - 1893
Ce qui est aujourd’hui le siège du quotidien Hanoimoi, est l'un des plus beaux bâtiments français de la fin du 19ème. Son style Art-Déco abritait « L'Avenir du Tonkin », le premier quotidien à paraître en vietnamien à Hanoi. Composé de huit pages, son directeur était le franco-allemand François Henri Schneider (dont nous reparlerons un peu plus tard).
En pratique :
Adresse : 44 Ly Thai To – Hoan Kiem
Le bureau de poste de Hanoi - 1893-1899
Le bureau de poste de Hanoi est l'un des premiers travaux de l’urbanisation à la française autour du lac Ho Guom comme centre de développement.
Le premier bâtiment a été conçu et construit par l'architecte Henri Vildieu en 1893 - 1899 dans le style de l'architecture néoclassique. En 1910, le bâtiment sera rénové, agrandi et mis aux normes de sécurité de l’époque. En 1943, le bureau de poste de Hanoi se voit dote d’un nouveau bâtiment au style architectural moderne, au coin des rues Dinh Tien Hoang et Dinh Le. L'œuvre est de l'architecte Henri Cerutti - Maori.
En pratique :
Poste Centrale de Hanoi
75, Dinh Tien Hoang

La Banque d’Indochine au Tonkin - 1930
Construite entre 1926 et 1930 sur les plans de Felix Dumail, cet imposant bâtiment, à l’architecture puissante, mêle style Art Déco, tendances indochinoises et motifs vietnamiens, pour donner au final un des édifices les plus étonnants de ce courant architectural. Le hall central retient particulièrement l'attention, grâce à la lumière qu'il procure via des coupoles à double niveau dont l'obturation partielle est calculée en fonction du soleil, diffusant ainsi un éclairage agréable tout en protégeant des rayons directs du soleil.
Fondée en 1875, la Banque d’Indochine fusionnera en 1974 avec la Banque de Suez, pour devenir la Banque Indosuez. Elle avait deux autres succursales au Vietnam : une à Saigon et l’autre à Hai Phong. Pour la petite histoire, la Banque d’Indochine obtient dès sa création le privilège d'émission de la monnaie pour la Cochinchine (et Pondichéry) ; elle remplacera par des "piastres" les anciennes monnaies utilisées jusqu'à cette époque (sapèques, nen vietnamiens, taëls..). La banque, d'abord installée dans des locaux modestes à Saigon, va accompagner le formidable essor économique des années 20. Il s'agira alors de construire des bâtiments en rapport avec la puissance de la banque. Cela a été chose faite…
En pratique :
Banque d’Etat du Vietnam
49, Ly Thai To
La résidence du gouverneur général d'Indochine – 1900-1906
Aujourd’hui Palais Présidentiel, cet élégant (et très couteux) édifice a servi de résidence au gouverneur général de l'Indochine française. Construit entre 1900 et 1906 à la demande du Gouverneur Paul Doumer et suivant les plans d’Auguste Henri Vildieu - architecte officiel de l'Indochine française - le bâtiment se compose d’une structure de trois étages avec 30 chambres. Situé au nord du mausolée de Ho Chi Minh, le palais hébergeait un certain nombre de généraux de l'Indochine avant de devenir la résidence officielle du Président du Vietnam. Avec ses nombreux éléments empruntant à la Renaissance Italienne, ses seuls points de repère orientaux sont les manguiers du jardin… L'intérieur est somptueux, avec une grande salle de cérémonie de style Louis XIV, tandis que la grande salle à manger est Renaissance. L’appartement privée du gouverneur général reflète l'ambiance de style Empire. Si chaque gouverneur général a mis son grain de sel, le palais garde cependant sa beauté intemporelle au-delà du temps et de l'espace. L'entrée est interdite au public, sauf certaines zones du parc, moyennant un droit d'entrée. Apres l’indépendance du Pays en 1954, le Président Ho Chi Minh refuse de vivre dans le luxe du palais (mais y donne des réceptions et y récit des ambassadeurs et autres dirigeants). Il fera construire en 1958 une maison traditionnelle sur pilotis derrière le palais, qui lui servira à la fois de résidence et de lieu de travail jusqu'à sa mort en 1969.
En pratique :
Adresse : 2 Hung Vuong, Ngoc Ho, Ba Dình
L’Université d’Indochine - 1906
Parmi les édifices emblématiques de l’architecture française à Hanoi, figure l’actuelle Université nationale du Vietnam, autrefois Université d’Indochine.
Dans l’histoire du Vietnam, l’enseignement a toujours joué un rôle très particulier. Il y a plus de 2000 ans, sous l’influence de la domination chinoise, l’enseignement confucéen a été introduit au Vietnam. Dès le 11ème siècle, la dynastie des Ly se base sur l’enseignement et le système de concours confucéens pour choisir ses mandarins. À partir du 16ème, les doctrines confucéennes ont une place dominante dans l’éducation et la politique nationale du Vietnam. Les Français quant à eux, mettront en œuvre diverses stratégies pour supprimer l’enseignement traditionnel et installer pas-à-pas un système d’enseignement français, ainsi qu’une politique de diffusion de la civilisation française. La réforme de Beau en 1906 renforcera le caractère occidental de l’enseignement, tout en préservant certains traits de l’enseignement traditionnel. Mais au final, la réforme promulguée par Albert Sarraut en 1917 signera la victoire de l’enseignement occidental, avec pour objectif le développement du colonialisme et de la culture française. Bien que la création de l’Université indochinoise en 1906 n’ait été qu’une mesure politique, elle fut considérée comme un point important dans l’histoire de l’enseignement supérieur en Indochine.
Signée de l’’incontournable Ernest Hébrard, cette construction aussi imposante que charmante est un point fort d’une visite des sites historiques et architecturaux de Hanoi.
En pratique :
Adresse : 19 rue Le Thanh Tong
Collège du Protectorat – 1908 / Maison Schneider
Aujourd’hui lycée Chu Van An, l’école était également connue des enseignants et des élèves – jusqu’en 1945 - sous le nom de « truong Buoi », lycée Buoi, du fait de son emplacement dans l’ancien village de Ke Buoi (pamplemousse), baptisé par les Français "Village du papier" à cause de ses ateliers familiaux de fabrication de papier traditionnel. Elle a été créée en décembre 1908, sur proposition du Gouverneur Général de l'Indochine, un certain Antony Wladislas Klobukowski. Si elle avait comme intention de former des fonctionnaires locaux au service de l’administration coloniale française, l’école a cependant connu de nombreux étudiants – les Buoi – qui deviendront des leaders politiques ou des personnalités du monde culturel de premier plan, réputés pour leur lutte anticolonialiste. L’administration préconisait un "enseignement franco-indigène" permettant de légitimer le colonialisme, d’apaiser la soif d’études des Vietnamiens, de détourner les esprits de l’attrait millénaire pour la culture chinoise et pour le mouvement patriotique, et de former des cadres pour l’appareil administratif. C’est dans cet esprit qu’est né le collège du Protectorat, dont l’installation se fit dans les locaux de l’ancienne imprimerie Schneider. D’ailleurs, la résidence de cet ancien magnat de la presse a été intégrée au lycée pour devenir la résidence du Principal. Cette somptueuse demeure a été construite en 1898 pour celui qui a été l’un des premiers éditeurs de cartes postales du Tonkin, dans les années 1885-1900. Henri Schneider a été également l’éditeur/directeur du Journal officiel de l’Indochine, il a fondé la Revue indochinoise et a été directeur de L’Avenir du Tonkin. Sa villa de trois étages est une débauche de frontons ornés de têtes d’anges alors que son porche monumental est parcouru de dragons en stuc entourant l’idéogramme PHUC, qui signifie « Bonheur ». Cette meringue architecturale a été restaurée fin 1999 grâce au soutien de la Région Ile de France pour devenir un centre culturel francophone, avec sa bibliothèque et ses cours du soir.
En pratique :
Adresse : 10, Thuy Khue - Tay Ho
Le Palais du Tonkin – 1919
Avec un style fait penser à un hôtel particulier du second empire, l’actuelle Maison des hôtes d'État a été conçue par Auguste-Henri Vildieu, puis construite entre 1918 et 1919 – selon les plans de l’architecte Adolphe Bussy - pour abriter le gouverneur français du Tonkin. L’édifice a été renommé Palais du Tonkin lorsque le Viet Minh a repris le nord du Vietnam. Son architecture élégante se distingue par son imposante grille d'entrée, sa rampe d'accès, l'escalier d'honneur et surtout la superbe marquise en verre. Le bâtiment ne se visite pas, mais son apparence extérieure vaut le coup d’œil.
En pratique :
Adresse : 12, Ngo Quyen
Musée national d'histoire du Vietnam - 1926 - 1932
Anciennement Ecole Française d'Extrême-Orient et Musée Louis Finot, l’actuel Musée National d’histoire du Vietnam est un des plus attrayants d’Asie du Sud-Est. Figurant au patrimoine national, il résulte de la fusion en 2011 du Musée national d'histoire vietnamienne et du Musée national de la révolution vietnamienne. Il occupe l’emplacement et les locaux de l’ancien musée Louis Finot - un musée appartenant à l'École française d'Extrême-Orient - construit en 1926 et inauguré en 1932. Ce fleuron de l’architecture indochinoise a été conçu par les architectes C. Batteur et E. Hebrard. Sa silhouette peut faire penser à une pagode alors que les doubles murs et les balcons offrent un système de ventilation naturelle et une protection contre le soleil, typique du style indochinois.
Le musée préserve près de 200 000 objets et documents historiques et culturels inestimables, issus de différentes époques : depuis les origines du Vietnam jusqu'à la déclaration d'indépendance du Pays en 1945, soit pratiquement 2 000 ans d’histoire du Vietnam.
En pratique :
Adresse : 1 Trang Tien - Hoan Kiem
Horaires d’ouverture : Du lundi au dimanche de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, fermé le premier lundi de chaque mois
Site officiel : http://baotanglichsu.vn/fr
Ministère des affaires étrangères – 1927
Anciennement Ministère des Finances, le siège du ministère des Affaires étrangères à Hanoi a officiellement été classé en aout 2016 patrimoine national. Construit entre 1925 et 1928, son architecte est… Ernest Hébrard. Le bâtiment est considéré comme un des joyaux de l’architecture indochinoise à Hanoi. Bien que les visiteurs ne soient pas autorisés à visiter l'intérieur, cela vaut la peine de s'arrêter et d'admirer ce remarquable édifice. L'architecture indochinoise, caractérisée par ses balcons sculptés et des poutres de toit influencées par les conceptions des temples asiatique, se distingue ici par les lucarnes qui couvrent les fenêtres, les toits et les balcons. Depuis la place Ba Dinh et le mausolée de Ho Chi Minh, il ne faut qu'une minute à pied pour arriver ici.
En pratique :
Adresse : 1 rue Ton That Dam – Ba Dinh
Eglise Cua Bach – 1925-1931
Cette étonnante église se trouve le long de la rue Phan Dinh Phung - la plus belle rue de Hanoi. Portant à l’origine le nom d’Eglise des Martyrs, elle a été construite entre 1925 et 1931 selon les indications de l’inoxydable Ernest Hébrard. Située face à la porte Nord (Cua Bach, en vietnamien) de la Citadelle de Thang Long, elle prendra tout naturellement ce nom. Avec une forte influence Art-Déco baroque, cette église intègre cependant quelques éléments de l’architecture traditionnelle vietnamienne, en particulier la toiture en tuiles, telle qu’on la connait traditionnellement dans les temples et les pagodes. On remarque en son milieu le système typique de l’architecture indochinoise de Hébrard, qui allie ventilation et éclairage. L’intérieur est lumineux, mettant en valeur son style baroque. C’est le clocher, asymétrique par rapport à la conception globale de l’édifice qui fait le caractère unique de cette église catholique au Vietnam.
Cua Bac est l'une des trois principales églises de Hanoi, avec l'église de Ham Long et la cathédrale Saint-Joseph.
En pratique :
Adresse : 56, rue Phan Dinh Phung, Ba Dinh
Site web : https://cuabacchurch.com/

La liste pourrait encore s’allonger, en citant par exemple la villa au 90, rue Tho Nhuom, celle au 101, rue Tran Hung Dao, le château d’eau, les écoles Phan Dinh Phung, et Tran Phu, le club de la Marine (aujourd’hui siège du Département de l’éducation physique et des sports, achevé en 1939), le Tribunal suprême rue Ly Thuong Kiet…À côté de ces bâtiments administratifs ou du moins communautaire, sont apparues de nombreuses villas de familles françaises le long des rues Tran Hung Dao, Ly Thuong Kiet, Hai Ba Trung, Dien Bien Phu, Le Hong Phong, Phan Dinh Phung…
N'hésitez pas à nous contacter pour une visite guidée sur mesure de l’héritage architectural colonial dans Hanoi !
À découvrir les traces coloniales à Hanoi
Envoyez-nous vos commentaires sur : Héritage architectural de la période coloniale française à Hanoi
Champs obligatoires *
Vous pourriez aussi être intéressé
Idées de voyage
Besoin d'inspiration ? Découvrez quelques-uns des meilleurs circuits au Vietnam, très appréciés par nos clients. Un excellent point de départ pour vous aider à choisir le voyage au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Birmanie ou en Thaïlande qui vous convient le mieux, que vous partiez seul, en couple, en famille ou entre amis.
Et parce que ce voyage est le vôtre, personnalisez-le comme bon vous semble !
Circuit Vietnam Cambodge 15 jours
Circuit Vietnam Cambodge 15 jours: temples d’Angkor, Phnom Penh et Mékong vers le Delta, Saigon et Cu Chi, puis Hoi An, Hué, Hanoi, Ninh Binh et croisière dans la baie d’Halong. Deux pays reliés par le fleuve mythique.
Circuit panorama du Vietnam 15 jours
Circuit panorama du Vietnam 15 jours : un voyage du nord au sud mêlant Hanoi historique, vallées de Mai Chau, baie d’Halong magique, Hue, Hoi An et delta du Mékong enchanteur.
Circuit Vietnam 15 jours
Ce Circuit Vietnam 15 jours vous entraîne du charme intemporel de Hanoi aux rizières de Mai Chau et Pu Luong, de la baie secrète de Bai Tu Long aux trésors de Hue et Hoi An, avant de vibrer au rythme du delta du Mékong et de Saigon.
Circuit Nord Vietnam 10 jours
Circuit Nord Vietnam 10 jours vous guide hors des sentiers battus, entre rizières en terrasse, vallées brumeuses, lacs paisibles et cascades grandioses, pour une immersion culturelle et humaine inoubliable
Croisière Mekong du Vietnam au Cambodge 12 jours
Croisière Mekong du Vietnam au Cambodge 12 jours est une odyssée fluviale inoubliable entre villages authentiques, paysages enchanteurs et découvertes culturelles uniques.
Circuit route des photographes 15 jours
Circuit Route des photographes Vietnam 15 jours vous permet de découvrir les belles rizières en terrasse, les marchés locaux et les ethnies colorées du Vietnam.
Ce circuit vous intéresse-t-il?
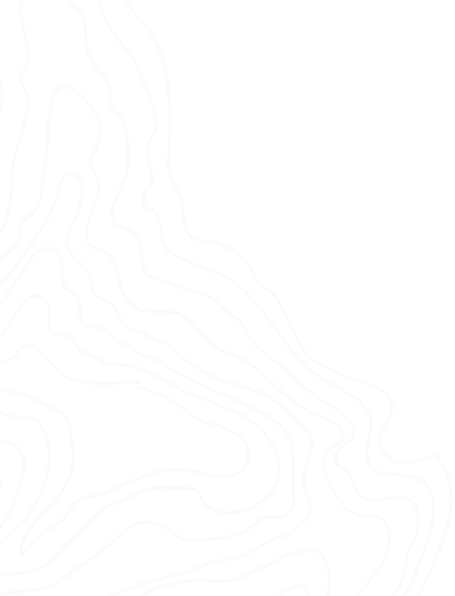











.jpg)



























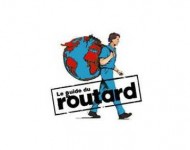



Commentaire